Calendrier de l’avant 2025 (15/31)
Un article ou entretien par jour pendant le mois de décembre pour revenir avec nous sur l’année cinématographique 2024 !
Mathieu Lericq : Fantômes du cinéma
Une année de recherches avec un spécialiste des cinématographies d’Europe centrale
par Lilou Parente et Valentin Chalandon
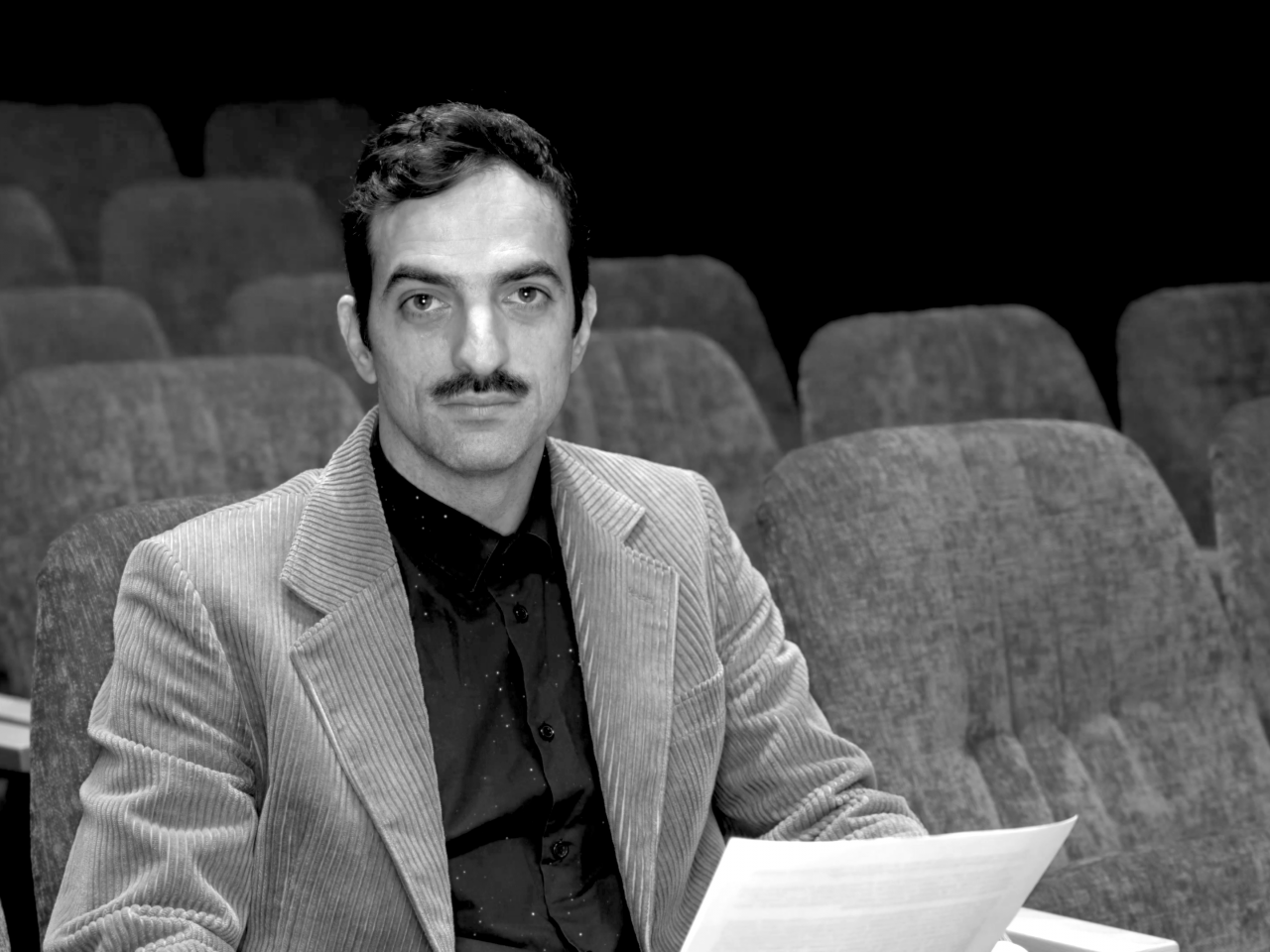
Mathieu Lericq est enseignant et chercheur en études cinématographiques, spécialisé dans les cinématographies d’Europe centrale. Dans cet échange, il revient sur les différents projets qui ont jalonné l’année 2024.
Quels ont été les grands moments de votre année universitaire ?
Côté pédagogique, l’année a été l’occasion de poursuivre mes enseignements dans deux institutions : à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye d’une part, et de l’autre à l’Université Paris 8. En outre, j’ai commencé à travailler pour une école privée. Cela m’a incité à modifier un peu la manière d’enseigner. C’est la première fois que j’ai assuré des enseignements appliqués pour des élèves dont la vocation est avant tout de faire des films, et pas seulement de réfléchir dessus.
Sur le volet recherche, l’année a été riche. Jusqu’à récemment, le territoire que concernaient mes recherches était principalement la Pologne. Cette année a été l’occasion de poursuivre mes travaux, mais en les ancrant dans une région composée de plusieurs pays : l’Europe centrale. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de travailler sur un grand cinéaste soviétique : Sergueï Paradjanov. Avec mon collègue Damien Marguet, nous venons de boucler l’édition d’un numéro de revue consacré au cinéaste hongrois Béla Tarr (publication prévue au printemps 2025). Un pan nouveau de ma recherche scientifique s’est ouvert à des contextes de production que je connaissais encore mal.
Au printemps, j’ai mené des recherches archivistiques à Prague, accompagné par le grand chercheur Xavier Galmiche, spécialiste de la littérature tchèque à la Sorbonne. Nous avons ensemble consulté des documents précieux au sein du centre d’archives littéraires (Památník národního písemnictví). J’ai pu accéder également à des documents éclairants au centre des archives filmiques (Národní filmový archiv). L’un des projets de recherche que je mène concerne la figuration du passé juif à travers la littérature et le cinéma en Europe centrale. Je me focalise pour le moment sur deux figures : l’écrivain Jiří Weil et le cinéaste Alfréd Radok. L’époque qui me semble à la fois passionnante et relativement inexplorée est la période de l’immédiat après-guerre : 1945-1949.
Ce projet de recherche fait écho à un travail de programmation mené dans le contexte culturel parisien. Il a donné lieu à l’organisation du cycle Une mémoire inquiète. Présences du passé juif dans le cinéma d’Europe centrale 1945-1967 au Musée d’art et d’histoire du judaïsme en mars 2024. J’ai compris à cette occasion que ce sont nos projets qui nous amènent à peaufiner nos expertises, et qu’on ne l’est jamais pleinement. J’ai longtemps nourri la crainte de ne pas être assez spécialiste, de ne pas être légitime concernant un objet d’étude. J’ai pourtant beaucoup lu, près d’une centaine de livres. J’ai également vu de nombreux films. J’accepte de ne pas être forcément expert de tout, et que l’important était d’avoir des choses à dire, mais aussi d’être capable d’échanger avec le public.
C’est un programme qui a trouvé son public ?
Par l’intermédiaire de quelques journalistes, en particulier Marc-Alain Ouaknin (producteur de l’émission Talmudiques sur France Culture), le cycle a pu être connu d’un grand nombre d’auditeurs. Et le public fut au rendez-vous. J’en étais le premier surpris. Mais j’en étais surtout ravi, évidemment. Il faut dire que toute l’équipe du musée a déployé une grande énergie pour garantir ce succès, des services de la bibliothèque à ceux de la librairie, en passant par la direction et le pôle communication. Avec Sophie Andrieu (responsable de l’Auditorium), nous avions l’intuition que cela marcherait. Avant tout parce que nous avons travaillé pendant plus d’un an à concevoir le programme, et qu’il nous semblait apporter quelque chose de nouveau.
À travers ce programme, je voulais créer du débat et susciter des discussions auprès de publics divers, autour d’un passé qui pose encore question : le passé juif (d’avant-guerre et d’après-guerre), et bien entendu l’extermination. Il me paraît important d’interroger la manière dont le cinéma, à partir de 1945, a pu être le lieu d’un silence sur les réalités passées, tout en devenant un espace d’évocation de cette histoire sous des formes spectrales. N’est-ce pas par le cinéma qu’un deuil s’est enclenché ?
Nous avons convoqué des cinématographies assez méconnues du public français. Certains films ont longtemps fait l’objet d’un tabou au sein même des pays où ils ont été produits. Ce mouvement de marginalisation continue, notamment avec la montée des partis d’extrême droite. Les discours mettent en avant des visions déformées de l’histoire. On a longtemps dit que les populations civiles seraient dénuées de toute responsabilité à l’égard de la discrimination des juifs. On a aussi créé le mythe selon lequel la Pologne était un pays catholique, niant ainsi l’héritage juif. Je me suis donc fondé sur des travaux d’historiens pour poser des questions d’images, m’intéressant par exemple au courant de renouveau historiographique appelé la « Nouvelle histoire de la Shoah », travaillant sur la mémoire juive à partir des traces laissées.

Affiche du cycle Une mémoire inquiète © Musée d’art et d’histoire du judaïsme
Quel rapport peut-on créer entre les recherches universitaires et la salle de cinéma ?
Impossible d’évoquer cette année sans évoquer les discussions menées dans les salles de cinéma. Le travail impulsé autour du cinéma tchécoslovaque avec l’association Contre-Plongée, m’a permis de me pencher sur cette cinématographie de façon plus détaillée. C’était très stimulant pour moi, j’ai pu approfondir mes recherches sur la mémoire juive, notamment chez Zbyněk Brynych et Juraj Herz, et plus globalement sur la place de la nouvelle vague tchécoslovaque dans l’histoire du cinéma, en réinterrogeant ses liens avec l’Histoire politique plus généralement.
Je trouve la démarche de Contre-plongée très pertinente car, à travers des outils de médiation, l’association a dépoussiéré cette cinématographie qu’on avait presque oublié depuis une vingtaine d’années où régnait une grande indifférence à son égard. Ces programmations ont permis de rendre visible des œuvres parfois complexes à comprendre pour le public français. L’intérêt est notamment qu’ils font appel à la recherche, créent une circularité entre les universitaires et le milieu culturel pour mettre à profit les recherches même sporadiques sur le sujet.
Dans ce cadre, il est important pour moi de refuser, par principe, la vulgarisation, d’éviter la forme de la conférence Ted, dont le principe est celui d’un chercheur se positionnant comme un expert. La position d’expert est moins importante que la position du chercheur qui a passé des journées à travailler sur des archives. Ce travail n’a rien de reluisant, il est fastidieux. Le croisement des informations et des enseignements qu’on peut en tirer, permet de mieux voir un film et de construire une discussion collective. Je crois qu’il est aussi utile que les spectateurs produisent leurs propres réflexions sur ces films. L’enjeu est de formuler des hypothèses.
Vous avez également conçu une programmation autour des adaptations cinématographiques de Milan Kundera au cinéma Reflet Médicis ?
Oui, les travaux autour du contexte tchécoslovaque ont continué à la rentrée avec le cycle Kundera en cinéma. Pour moi, analyser les images ne peut pas se réduire à écrire l’histoire du cinéma, mais cela revient d’abord à donner à des œuvres filmiques oubliées (ou marginalisées) leur place dans l’histoire. J’ai la conviction qu’il faut poursuivre les recherches de manière acharnée pour faire en sorte que des œuvres puissent être montrées, sous-titrées et rendues accessibles au public.
En tant qu’historien du cinéma, j’ai l’impression que plus on gratte du côté du passé, notamment avec le travail d’archives, plus on a envie qu’il prenne du sens dans le présent. Si ces œuvres du passé font sens individuellement pour les chercheurs, peut-être le font-elles aussi collectivement. Plus on a un conscience du passé, plus cela nous stimule intellectuellement dans le présent, et nous donne envie de revoir les tendances historiographiques et les remettre en question constamment.
Mon travail pédagogique m’amène constamment à interroger le schéma historiographique à employer pour parler de certains courants cinématographiques. Par exemple, je me questionne sur le cinéma classique hollywoodien. Pourquoi, quand on enseigne l’histoire du cinéma, Griffith est considéré comme un cinéaste incontournable ? Son importance est indéniable, mais il est loin d’être le seul. Par ailleurs, au-delà des considérations générales, de nombreuses problématiques peuvent être formulées si l’on bouscule l’approche qui consiste à considérer une cinématographie par le seul prisme du “cinéma national”.
Hollywood en tant que système regroupant divers studios mis en place au milieu des années 1910 a été nourri par de nombreux producteurs et cinéastes européens en exil. De nombreux clichés sur Hollywood peuvent être réinterrogés si l’on prend en compte l’influence de personnalités d’origine hongroise, polonaise ou ukrainienne. Je me demande aussi comment parler des femmes cinéastes de la période des années 1930, comme Dorothy Arzner, lesquelles ont été oubliées. Un autre enjeu important, c’est celui de la place à accorder à des figures comme Cecil B. DeMille. J’ai découvert qu’il avait produit deux adaptations des Dix commandements — l’une en 1923, et l’autre en 1956. Je trouve symptomatique que le cinéaste ait pu élaboré un tel travail avant et après la Seconde Guerre mondiale, son père étant d’origine protestante flamande et la mère étant issue d’une famille juive allemande. Que signifie raconter le destin du peuple juif au cinéma, à des moments précis où le tabou concernant la culture juive est partiellement levé ?
Ces réflexions s’articulent avec mes réflexions sur le Décalogue, une série que réalise à la fin des années 1980 le cinéaste polonais Krzysztof Kieślowski. La Filmothèque du Quartier latin vient de projeter l’ensemble des épisodes. Au-delà des questions éthiques soulevées par chaque épisode, je trouve intéressant que Kieślowski pose à nouveau, dans l’épisode huit notamment, la question de la place à accorder au passé juif dans le présent de la Pologne. Un jour, j’écrirai peut-être un article portant sur l’adaptation des Dix commandements au cinéma.

Affiche du programme Kundera en cinéma
Comment vous situez-vous dans le champ des études cinématographiques ? Comment votre recherche évolue-t-elle ?
L’inscription disciplinaire de mes recherches relève d’un défi. Un défi que je me lance à chaque fois que je forme un projet ou que j’écris un article. Je ne m’inscris pas dans un champ disciplinaire d’une façon classique. De facto les champs souvent s’entrecroisent, et tant mieux si l’on s’en tient aux résultats scientifiques. Je vois des historiens du cinéma qui élaborent de magnifique et très pertinentes analyses d’ordre esthétique. À l’inverse, des “esthéticiens” s’intéressent à des courants cinématographiques pour en apporter une vision puisant dans l’étude génétique. Par exemple, l’ouvrage collectif récemment publié, co-dirigé par Massimo Olivero, José Moure et Vincent Amiel, portant sur le réalisme des années 1930 (De René Clair à Jean Renoir. Les réalismes des années 1930), reprend parfaitement l’ambition qui doit présider en termes de croisements disciplinaires.
Si j’en viens à ma position disciplinaire, je ne me sens pas obligé d’adhérer pleinement à un champ, même si j’y suis parfois contraint, dans les colloques auxquels je participe par exemple. Je ne remets pas en question la légitimité du découpage de ces champs, mais je ne les considère pas comme des disciplines. De mon point de vue, la pertinence repose souvent sur les croisements qu’on peut opérer. D’un autre côté, c’est aussi un défi méthodologique quand on se met à rédiger des articles ou des livres. Ces champs renvoient chacun à des méthodologies spécifiques. Quand on croise les champs, il faut fonder sa propre méthodologie qui soit à la hauteur du sujet que l’on veut traiter. Et cela est loin d’être évident. Par exemple, en appliquant une méthodologie de philosophie esthétique, il est difficile de mobiliser tout le travail archivistique qui pourtant a été mené pour élaborer l’article.
Est-ce que vous croyez à un plus grand décloisonnement de la recherche ?
Je ne veux pas remettre en cause la légitimité de chaque discipline. Il y a des revues d’esthétique et des revues d’histoire du cinéma. Ces revues doivent continuer de porter leurs ambitions scientifiques respectives. Je suis très attentif à l’émergence d’autres champs de recherche au sein des études cinématographiques, comme l’approche gender ou l’approche postcoloniale.
Ce que je peux regretter au regard de mes propres recherches, c’est l’absence de considération du cinéma européen dans son ensemble. D’un côté, les recherches perpétuent un prisme national, l’enjeu étant d’investir le concept de “cinéma national”. D’un autre côté, des études transnationales sont menées, mais uniquement à l’égard de pays limitrophes à la France : ce sont surtout les relations franco-italiennes ou franco-allemandes qui se voient analysées. Je crois à l’éclosion, dans les années à venir, d’une approche transnationale du cinéma européen. Ma conviction disciplinaire, si je puis le formuler ainsi, est de redonner du sens au concept de cinéma européen. Si l’on considère les années 1920, par exemple, je trouve passionnant de comprendre les liens entre la naissance d’institutions cinématographiques nationales (suédoise, hongroise, polonaise, tchèque, etc.) et la trajectoire transnationale des cinéastes eux-mêmes, dans un contexte de montée des fascismes. On ne peut pas considérer les carrières de Friedrich Wilhelm Murnau, d’Ernst Lubitsch ou de Fritz Lang sans définir la valeur des circulations transnationales.
Certains cinéastes hongrois en sont les exemples parfaits. Manó Kertész Kaminer, réalisateur d’origine juive de Budapest, choisit le nom de Mihály Kertész dans les années 1910 pour réaliser des films au Danemark, à la Nordisk Film. Il travaille aussi en Suède, avec Victor Sjöström et Mauritz Stiller. Il revient ensuite en Hongrie pour poursuivre sa carrière. Dans le contexte de guerre civile en 1919, il est contraint de quitter le pays à cause de la « terreur blanche » exercée sur les juifs, les intellectuels et les communistes. Mihály Kertész devient Michael Curtiz à Hollywood, et réalise en 1942 un chef-d’œuvre inoubliable : Casablanca. Mais on pourrait également évoquer la trajectoire complexe d’Alexander Korda, à qui l’on doit Marius en 1931, adapté de Marcel Pagnol.
Je m’interroge beaucoup sur la transnationalité du cinéma. Je suis ravi de constater que des travaux aient pu développer cette approche, notamment à travers le livre L’Europe du cinéma, co-dirigé en 2023 par Vincent Amiel, José Moure, Benjamin Thomas et David Vasse. Ce mouvement pourrait se prolonger afin de rompre avec des idées reçues, comme celle que le cinéma ouest-européen aurait une valeur plus grande que le cinéma centre- et est-européen. Ma conception de l’histoire du cinéma est marquée par l’horizontalité. L’approche comparatiste pourrait aussi déboucher sur des recherches stimulantes.
Y’a-t-il un événement récent qui impulse selon vous une considération transnationale du cinéma ?
Je pense à l’exposition Chantal Akerman. Travelling au Jeu de Paume, qui est un événement crucial de l’année 2024. Chez Akerman, chaque geste filmique répond à un grand désespoir. Dans Saute ma ville (1968), elle décrit la mise en place d’un geste suicidaire. Dans D’est (1993), elle filme les habitants de Moscou comme s’il s’agissait de pantins, de fantômes à qui l’on ne peut même pas donner la parole. Ils semblent sidérés par les changements politiques en cours. Les conséquences intimes de l’effondrement de l’Union soviétique se logent au cœur de l’esthétique, dans un silence assourdissant. Cela rend le film désarmant et fascinant aussi, alors qu’il est tourné à peu près au moment de la publication des Spectres de Marx de Jacques Derrida. Trois chercheuses ont consacré récemment une très belle étude à la réalisatrice : Intérieurs sensibles de Chantal Akerman. Films et installations – passages esthétiques. Le livre a été co-dirigé par Olga Kobryn, Macha Ovtchinnikova et Eugénie Zvonkine.
En discutant avec un spécialiste de l’histoire russe, Dimitri Filimonov, une idée a jailli. Les lents travellings produits par Akerman à Moscou, cette façon de les faire défiler sans jamais leur donner la parole, comme s’il y avait une frontière invisible entre eux et la réalisatrice : tous ces éléments nous ont fait pensé à la manière dont on avait filmé les survivants de la Shoah, au moment de la libération des Camps. Cela reste une hypothèse, bien entendu. Et il faudrait étayer cette idée sans faire d’amalgames. Mais les fantômes de la Shoah irriguent, consciemment ou inconsciemment, les films de la réalisatrice. On sait que la famille d’Akerman a été très touchée par la Shoah. Son cinéma, par l’esthétique, est une réflexion sur tout un pan de la catastrophe, prenant constamment d’autres formes. Chez Akerman se joue en même temps une difficulté de formuler le passé, le spectateur étant souvent placé à côté du récit. Son cinéma apparaît comme une plaie ouverte, qui ne permet pas vraiment une cicatrisation. Les travaux d’Ophir Levy me semblent passionnants en ce qui placent les spectres de la Shoah au cœur des réflexions sur le cinéma.

Affiche de l’exposition Chantal Akerman. Travelling © Jeu de Paume
Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux images et au cinéma ?
Si le cinéma est au cœur de ma réflexion, c’est en grande partie parce que l’image me semble le lieu privilégié de révélation du passé (et du présent) sous une forme fantomatique. La question du corps filmé me stimule beaucoup car la peau au cinéma devient par le cinéma une matérialité énigmatique, qui perd son caractère proprement physique pour souvent devenir l’objet d’une démarche renvoyant à la métaphysique. Le cinéma est moins un lieu de représentations qu’un lieu de figurations, souvent en proie à des traumatismes.
Grégory Delaplace vient de publier un essai formidable : La Voix des fantômes. Quand débordent les morts (2024). Il montre à quel point nos vies sont marquées par la présence de fantômes, des êtres qui sont morts qu’on passe notre temps à tenter de faire parler. Mais si le cinéma révèle des morts-vivants, cela n’en fait pas pour autant un lieu de morbidité. Au contraire, il est l’espace d’expression d’une vitalité. Même un cinéma a priori morbide — je pense à L’incinérateur de cadavre (Spalovač mrtvol, 1969) de Juraj Herz ou La Clepsydre de Wojciech Has (Sanatorium pod Klepsydrą, 1973) — nous démontre la valeur de la vie, par-delà les cauchemars. Regarder ces films nous donne encore plus envie de vivre, d’aimer et de lutter.
Peut-être un pas de côté sur le cinéma contemporain ?
J’entretiens un rapport un peu particulier avec le cinéma contemporain. C’est surtout mon travail de critique, pour BREF magazine, qui m’amène à saisir quelques tendances du cinéma contemporain. Le fait de mener des entretiens auprès de jeunes cinéastes me permet de comprendre ce qui se joue dans le court métrage aujourd’hui, notamment en France. J’ai remarqué par exemple l’importance de l’écriture de soi dans le cinéma contemporain, qui s’avère ni narcissique ni égoïste. Certains cinéastes se demandent comment dire “je” dans le monde actuel, comment se raconter, comment figurer une émancipation vis-à-vis du milieu familial et des traumatismes intergénérationnels accumulés.
La question de l’écriture de soi par le cinéma est passionnante car elle n’est pas hermétique à l’égard du monde extérieur. Elle repose la question de l’ancrage dans les contextes. Surtout elle dit quelque chose, loin des réductions idéologiques, de la complexité des généalogies qui précèdent notre naissance. Les films indiquent ou prouvent la complexité des liens familiaux, souvent en prise avec des cultures et des religions multiples. Les modalités d’identification échappent en partie aux individus, elles sont souvent le fruit d’un choix et d’un contexte, ce qui rompt avec les prescriptions morales préconçues.
Ces questions renvoient aux démarches de deux jeunes cinéastes: Noah Cohen et Sara Ganem. Le phénomène de croisements culturels est au cœur des films du premier réalisés dans le cadre des ses études à la CinéFabrique à Lyon : Last Call (2021) et Que les meilleurs gagnent (2022). De son côté, Sara Ganem a fait un film, Petit Spartacus (2023), qui raconte ses traversées de l’Europe à vélo. Elle s’est rendue compte au moment du montage que ces voyages avaient peut-être été un moyen de réparer le traumatisme provoqué par un harcèlement sexuel vécu. Le film devient alors le lieu de formulation et de critique des violences que les hommes peuvent faire subir aux femmes.
Outre le magnifique film roumain Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde (Trei kilometri până la capătul lumii, 2024) d’Emanuel Pârvu, le long métrage qui m’a le plus impressionné cette année est un documentaire : Se souvenir d’une ville (2024). Il a été réalisé par Jean-Gabriel Périot, l’un des cinéastes contemporains les plus audacieux. Le film mobilise un corpus filmique assez troublant composé de vidéos tournées par des soldats de l’armée bosniaque au moment du Siège de Sarajevo (1992-1996). À l’époque, les jeunes hommes qui ont filmé la guerre ne savaient pas vraiment ce qu’ils faisaient. Jean-Gabriel Périot a fait un travail archéologique pour tenter de redonner du sens à ces images du passé, tout en essayant de comprendre le parcours de chaque personne depuis la guerre. Car leurs images portent leurs traumatismes. Je trouve cette démarche enrichissante mais aussi bienvenue, dans le sens où elle est politiquement très engagée.

Se souvenir d’une ville © Jour2fête
Entretien réalisé le 11 décembre 2024
